« Bon. Et maintenant qu’est-ce que je fais ? »
Je me souviens de m’être traité de déficient mental (en trois lettres, commençant par un «c») alors que m’apparaissait cette triste pensée. Quand on pilote, être désorienté, sans savoir que faire n’est pas une situation d’avenir. A ma décharge (ou pour enfoncer le clou, selon), je n’étais pas en vol à ce moment-là, mais bien au sol, en pleine possession de mes moyens, à l’entrée d’Ushuaia, la ville la plus australe du monde. Je venais rejoindre l’aventure du Raid Latécoère

Située en bordure de la baie de la Terre de feu, à proximité du canal Beagle, Ushuaia était la dernière étape de l’ancienne ligne Buenos Aires – Ushuaia, celle utilisée du temps de l’Aéropostale et que venaient de parcourir les autres pilotes du Raid. Pour moi, elle représentait surtout un énième choc thermique. Etant passé du temps maussade de la région parisienne en fin d’hiver, aux températures estivales de Buenos Aires, je me retrouvais à nouveau dans une météo que n’aurait pas reniée un pêcheur de la presque-île du Crozon. En fait, ce temps capricieux – je l’appris seulement à mon arrivée – fut la raison pour laquelle les autres avions du Raid n’étaient pas passés et restèrent à El Calafate… à 850km de là où je me trouvais donc. Cela arrivait deux années sur trois.

Ayant la désagréable l’impression de manquer mon Raid avant même de le commencer, j’apprenais l’existence de l’aéroclub d’Ushuaia, près de l’aéroport (logique) et surtout, la présence d’autres participants du Raid qui, comme moi, avaient commencé par cette étape. Je les y rejoignis et fis connaissance avec l’équipe : Fred, pilote d’hélicoptère, Michel, dirigeant d’une petite entreprise et Joël, boucher de formation. C’est ainsi que ce joli petit monde décida, malgré les imprévus, de faire ce pourquoi il était venu : voler, en commençant par le bout du monde. Antonella, notre pilote, démarra le PA28 après nous avoir briefés et le fit décoller sur le seul quart de la piste utilisable, alloué à l’aéroclub. Le vieux destrier de métal nous arracha au sol du mieux de ses forces et nous amena en terre promise. Voler à cet endroit avait quelque chose d’à la fois grandiose et réconfortant. Grandiose de par le panorama : à l’ouest du canal Beagle s’étendait le « Parque Nacional Tierra del Fuego », formant la frontière avec le Chili et au sud, le canal Murray, porte d’entrée vers l’Antarctique.

Réconfortant également, car même sans se le dire, nous avions tous la même sensation à ce momentlà : celle d’être là où il fallait être. En cet instant, malgré nos déboires respectifs, nous étions les braves gens les plus heureux du monde. Mais à peine en avions-nous profité qu’il fallut nous poser rapidement, à l’approche des grains. Chacun en profita pour visiter la ville à sa guise. Avec ses maisonnettes colorées et sa pluie battante, Ushuaia ville portuaire, ressemblait beaucoup à celles que l’on peut voir dans le nord de l’Europe. Le souvenir pesant de la bataille des Malouines en prime, non négociable.

Le lendemain, nous avions enfin rejoint les autres pilotes du Raid, à El Calafate, afin de prendre la relève : certains partaient, nous arrivions. A peine avions-nous posé les valises dans le hangar que Cristian, l’instructeur argentin attitré à notre avion, nous proposa d’essayer ce PA28 « brique tout métal » au-dessus du panorama. Souhaitant nous assurer que les montagnes, les glaciers et les lacs que nous avions vus sur les cartes postales n’étaient pas une pub contractuelle, nous acceptions bien sûr ! Ce n’était pas une pub contractuelle : le paysage nous offrit en un coup d’œil des présents parmi les plus beaux que la Terre pouvait encore nous offrir. Sur le bord Nord de la piste : le Lago Argentino, bleu d’une pureté comme seule la nature savait la peindre. Plus loin, la chaîne de la Cordillère et le Mont Fitzroy, la pampa en contrebas. Et à l’ouest, le glacier du « Perito Moreno » l’un des seuls au monde à ne pas reculer malgré les années. En enfants sages, nous laissions la Cordillère à distance pour nous contenter d’un simple tour du jardin. Un jardin de la taille de la région parisienne. Pas besoin de carte par ce temps : les paysages étaient grands, simples mais magnifiques, la visibilité parfaite. Après avoir léché cette belle vitrine depuis le ciel, il était temps d’entrer dans le magasin à proprement parler, en découvrant la région depuis le sol. Le lendemain matin fut ainsi consacré à la visite du glacier. Organisée par le parc, à bord d’un bateau rempli à ras-bord de touristes (dont moi), celle-ci me sembla néanmoins un peu triste et sans âme. Le côté « balisé » ou « effet de masse » sans doute. Je me promis alors de me tenir dorénavant loin de ce genre de circuit. Ressentant une soudaine fibre écologique, l’appel de la nature au plus profond de mon âme, c’est en vélo que je devais explorer la pampa pendant le reste de la journée, poussant même le vice jusqu’à prendre un vélo en bambou. Un élan digne de Greta Thunberg, pour lequel mes abattis m’en voudront beaucoup.

En marchant dans les larges rues de lotissements « à l’américaine » de la ville, je remarquais une chose que j’avais déjà vue à Ushuaia : les chiens errants. Ils y étaient incroyablement nombreux dans les zones habitées, comme je le verrai plus tard. Mais ce n’était pas aussi triste que cela en avait l’air. Je notais en effet leur poil en bon état et leur comportement amical. Les habitants y étaient tellement habitués que les chiens pouvaient toujours trouver de quoi se nourrir. On n’a pas de gentils chiens à tous les coins de rue à Paris. Mais on a des pigeons.

Enfin, le Raid bougeait. Levés de bon matin, les instructeurs nous briefaientsur la route à venir. Navigation, météo, points de ravitaillement, procédures d’intégration, tout y passait, rapidement mais efficacement. Nous regardions silencieusement défiler les montagnes, le gravier mat et cette végétation basse si caractéristique de la pampa argentine, alors que nous roulions vers l’aéroport. Un paysage sauvage, un peu hors de notre époque, que n’aurait pas renié John Ford pour ses westerns. Impression renforcée par les checkpoints militaires répartis sur notre route. Avec leurs fusils chargés et leur regard à l’affut de la moindre anomalie, il ne faisait aucun doute que la présence des autorités allait bien au-delà de l’aspect décoratif. Très clairement, nous n’étions pas en Europe. Papiers en règles, nous nous dirigeâmes vers les avions, chargions les bagages et décollions. L’air était frais et le lever de soleil magnifique. La ville d’El Calafate se réveillait doucement alors que trois mille pieds au-dessus, le soleil brillait déjà pour nous. Le PA28 « Arrow », pas variable et train rentrant, était un avion lourd aux commandes mais plutôt agréable en vol. Bien trimé, c’était un véritable petit avion de ligne, confortable pour les pilotes et les passagers. Mais il était bourré de petits défauts. L’un d’eux se trouvait sur la porte latérale, qui avait la sale habitude de s’ouvrir en plein vol, sans vouloir se refermer ensuite. Mais cela ne dérangeait pas les pilotes, la majeure partie du courant d’air ainsi créé se déversant sur les passagers en place arrière. Oh et c’était moi le passager en place arrière sur ce vol. En homme de la Sibérie, élevé par les ours polaires et me douchant à l’eau de Bretagne, je ne laissais rien transparaître de ma gêne et regardais la surface de la terre défiler sous l’aile. Une surface pleine de grands cratères remplis d’eau et un peu enneigée, qui se faisait de plus en plus sombre et stérile, à mesure que nous approchions de l’aérodrome de « Perito Moreno ».

C’est ce moment que choisit Cristian pour nous dévoiler le secret des argentins pour tenir à toute heure de la journée : le maté. Une plante, cueillie dans les forêts au centre du continent, introduite sèche, directement au fond d’une calebasse où l’on y versait de l’eau très chaude. C’était une boisson très amère, assez spéciale pour le palais peu aventureux des européens. Il était possible de jouer sur la quantité de maté, de la température de l’eau, d’y ajouter du sucre ou non. Mais Cristian était un jeune vieux de la vieille et le prenait chaud, concentré et sans sucre (sacrilège fût-ce autrement). Une odeur du siècle dernier flottait sur la petite plateforme de Perito Moreno, perdue au milieu de nulle part. On y faisait les choses à l’ancienne, avec un seul bâtiment-hangar en tôle, une piste aménagée en gravier et un ravitaillement en essence à la force du bras, avec sceaux et entonnoirs.

Prenant la place du pilote au décollage, je m’assurais de bien faire les essais moteurs sur le seul mètre carré goudronné et sans graviers du taxiway, afin d’éviter que ceux-ci, soufflés par l’hélice, ne viennent endommager la carlingue.

Trois heures et environ quatre cent nautiques plus loin, adieu le désert, nous voici au-dessus du Lac de Constance, en Suisse. Fondée par un ressortissant Helvète, la localité de San Carlos de Bariloche était réputée pour ses montagnes et ses stations de sport d’hiver. Elle fut construite selon le modèle des villages suisses et comportait ainsi hôtels, chalets en bois, chocolateries et tout ce qu’il fallait pour vous aider à aller mieux si vous étiez suisse et que vous aviez le mal du pays. Cette ville eut d’ailleurs un tel succès dans ce domaine, que de nombreux criminels de guerre nazis y trouvèrent refuge. Toujours était-il que, vu du ciel, le paysage boisé tranchait radicalement avec ce que nous avions vu jusqu’ici et l’approche fut à couper le souffle. Sur le tarmac cependant, les zones arides et les montagnes aux crêtes rouges qui nous entouraient nous donnaient plus l’impression de nous être posés dans le désert du Mojave. C’était là tout le paradoxe de voyager en Argentine : on y voyait des reflets venus d’ailleurs, partout autour de nous.

A ce stade, je commençais à accuser le coup. Ce n’était pas juste voler, mais surtout le fait d’être en permanence sur la brèche. J’avais à ce moment-là compris que le Raid ne laissait aucun temps mort. A peine posés les bagages à l’hôtel, après moult contrôles douaniers, fallait-il sortir. Nous restions rarement plus de quarante-huit heures sur place, ce qui nous laissait peu de temps pour manger, dormir, recharger les batteries des caméras/téléphones et surtout, sortir pour visiter l’escale où nous nous trouvions. Prendre le temps de communiquer avec les proches et poster quelques mots sur les étapes prenait beaucoup plus temps que cela en avait l’air. Quoi manger n’était au moins pas une préoccupation. Le Raid prenait de fait en charge les repas du soir, qui pour la modique somme de 2800€ payés pour la « logistique », se déroulaient tous au restaurant. Et les argentins savaient manger copieusement. De la viande surtout. Beaucoup de viande. Vous pouviez aller vous-même près des cuisines, choisir votre pièce de viande et sa cuisson. L’animal et le boucher jouaient ensuite leurs rôles respectifs. Une fois de plus, l’Argentine à la hauteur de sa réputation. Il y avait ainsi deux types de personnes que les argentins vilipendaient : les vegans et les chiliens. En parlant des chiliens, c’était cette fois à eux que nous allions rendre une petite visite. Sept heures du matin à l’aéroport, nous n’avions prévu de décoller qu’à neuf heures. En cause, les contrôles douaniers draconiens. En effet même si nous voyagions à bord d’avions légers, nous utilisions tout de même des plateformes internationales et devions donc nous conformer aux règles de sécurité.

A neuf heures sur la piste, des nuages bas nous attendaient à Puerto Montt, où nous devions nous poser, ce qui créait une attente supplémentaire sur le tarmac, en plein désert. Un vent chaud et sec nous soufflait au visage et faisait tourner un vieux moulin de style far-west, alors que nous attendions sous les ailes de nos avions, chapeaux sur la tête, le cri des rapaces au-dessus de nos têtes. Le chef pilote nous signalait alors une trouée prévue dans une heure trente au-dessus du Chili. C’était le moment de partir. Le passage des reliefs de la Cordillère se fit sans incident : cette partie de la chaîne était peu élevée et la navigation était facilitée par le « Calbuco », un gros volcan bien situé en face de nous, porte d’entrée du Chili. L’avion longea le monstre pour ensuite s’engouffrer tant bien que mal dans une trouée, qui nous téléporta en pleine campagne anglaise : une épaisse couche de nuages formait un plafond à mille pieds du sol, un sol au demeurant très vert, rappelant fortement le bocage anglais. Après avoir rassemblé, les trois avions du raid se posèrent successivement sur l’aéroport international de Puerto Montt. Nous avions réussi : pour la première fois depuis sa création, les avions du Raid Latécoère se posaient au Chili.

Libérés, délivrés des tracasseries administratives après seulement quatre heures de paperasses (et un contrôle des bagages draconien durant lequel je fus emmerdé pour une peau de banane), nous survolâmes la ville afin de poser les avions à l’aéroclub de Puerto Montt. Ce saut de puce passé et les bagages déchargés, nous reprenions daredare les airs, cap à l’Ouest, pour tomber sur l’océan Pacifique. S’étendait en face de nous un paysage d’eau, pur et immense, au bout duquel nous aurions pu tomber sur la Nouvelle-Zélande, neuf mille kilomètres plus loin. La profondeur de l’océan résonnait à travers l’horizon, cet horizon face auquel nous nous sentions peu de choses et dont nous ne serions jamais revenus si nous avions poursuivi notre route vers le soleil déclinant. Sautant d’ilots en ilots, nous remontâmes vers le nord, suivant la côte dans un premier temps, puis à travers les vallées boisées des terres. La densité de la végétation rappelait celle que l’on pouvait trouver sous les tropiques Le retour au soleil couchant fut l’un des plus beaux vols qu’il était possible de faire. Sur un flanc de crête, celui- ci prêtait son aura aux arbres du versant et de l’autre côté, les nuages, restés bloqués, formaient un tapis immaculé jusqu’au pied du volcan.

Au-dessus de ce dernier s’était formé un nuage lenticulaire impeccable, une coiffe en forme de chapeau chinois, parfaitement seyante pour flatter ce monstre endormi. Ce vol fut la quintessence de tout ce qu’il y avait de magnifique dans le fait de piloter. Les conditions étaient idéales, l’air stable, le cheminement simple. Hormis quelques paramètres de l’avion à surveiller, toute notre attention s’attachait à graver cet instant dans nos mémoires. Un moment sans contrainte, hors de la vie de tous les jours. En cet instant, nous étions intouchables.

Mais il est toujours un peu étrange de voir à quel point le ciel peut être détaché de ce qu’il se passe au sol. Située dans le renflement d’une lagune, Puerto Montt était une ville de pêcheurs. Cela se sentait. Littéralement. La plupart des commerces de pêches étaient installés sur les pontons, près du rivage et la ville ne vivait globalement que de cela et du tourisme. La côte était faite de galets et de bateaux échoués. En contrebas des pontons, se trouvaient une demi-douzaine d’éléphants de mer somnolant tranquillement. Les habitants d’un pays n’étant pas forcément comme leurs douaniers, les chiliens étaient amicaux. Ils vous invitaient à goûter des oursins et gardaient le sourire malgré la précarité de la ville. La fracture sociale entre l’Argentine et le Chili était ici flagrante : un peso argentin valait deux cent pesos chiliens, les installations étaient plus qu’insalubres et les sans-abris présents à chaque coin de rue. Il n’était d’ailleurs pas rare pour un touriste de se faire aborder par une femme plus ou moins âgée et en tenue légère, dont la proposition de vente tenait moins du poncho souvenir que du service horaire à la personne… Il fallait dire qu’avec mes lunettes de soleil, mon grimpant plein de boue et les bottes fourrées que je me trimbalais depuis Ushuaia, je faisais un pigeon épatant ! Je poursuivais ma route et rentrais à l’hôtel, cet Ibis flambant neuf au pied duquel s’entassaient les sans-abris et des chiens en nettement moins bonne santé qu’en Argentine.

Après un jour de plus passé au Chili pour cause météo, nous reprenions le chemin de la Cordillère. Quitter le pays fut pour le moins difficile. Le plafond étant très bas, nous étions contraints de rester à seulement six cent pieds au-dessus d’une eau à cinq degrés. Certes nous étions près des côtes, mais à cette altitude, en cas de panne moteur et si nous ne pouvions rejoindre le rivage, l’espérance de vie dans une eau à cette température était de cinq minutes. L’atterrissage d’urgence de Romane au milieu de nulle part, sur le chemin de l’aller, était encore dans les esprits. Cela n’arrivait pas qu’aux autres. Soudainement, un rayon solaire traversant la grisaille nous indiqua une trouée de ciel. Ni une ni deux, nous montâmes en tire bouchons pour nous hisser dans le ciel, histoire de nous assurer que le soleil y brillait toujours, au-delà des nuages. A partir de là, tout fut beaucoup plus simple. Trois mille cinq, cinq mille cinq, huit mille cinq… alors que l’altimètre montait, la tension elle, redescendait. Ca recommençait à rire dans le cockpit, je trimais l’avion, on servit le maté, et l’on s’installait confortablement dans le siège. La Cordillère refranchie, nous étions de retour à Bariloche. Fin de la parenthèse chilienne du Raid, à bien des égards la plus mémorable. La fin de la route pointait le bout de son nez, et pourtant nous étions encore à mi-chemin de Buenos Aires. Un bond en avant de plus de huit cent nautiques, qu’il nous faudrait faire en deux jours. Le ballet du chargement recommença et les avions s’élancèrent une fois de plus au-dessus de la Pampa aride, en direction de Santa Rosa. Sans rire, j’eus l’impression de survoler le Colorado tant les plateaux étaient rouge. John Ford et ses westerns spaghettis revenaient s’encombrer dans ma tête, alors qu’en place arrière j’essayais de prendre quelques clichés potables au travers de la verrière. Je zoomais autant que faire se pouvait. Peut-être espérais-je surprendre trois bandits en plein impasse mexicaine ?

Toujours était-il que par endroits, c’était Alexandre ou Léonidas que j’aurais pu surprendre car l’eau turquoise du Rio negro donnait un véritable air méditerranéen à ces falaises que nous survolions. Dans ce pays, je n’en finissais pas de voir les reflets du monde, de ce que j’en avais vu de mes yeux et de ce que j’en imaginais. Les paysages, l’identité culturelle, l’art de vivre, la cuisine, l’Argentine était un pays ayant tout pour lui. Le temps d’une halte à Neuquèn, sorte de Clermont Ferrand à l’Argentine (en plus moche) et nous repartions vers Santa Rosa, où la météo nous réservait son baroud d’honneur. Un grain menaçant s’amoncelait au-dessus de notre destination, comme pour nous empêcher de conquérir cette dernière place forte avant la capitale. Mais le petit PA28, qui nous avait si fièrement porté depuis le bout du « cône » argentin, ne l’entendait pas de son oreille. Son équipage, à l’intérieur et donc bien obligé de le suivre, non plus. Guidé par Cristian, je fis voler l’ « Arrow » entre les nuages, où des veines saillantes d’éclairs se faisaient voir par moments. S’en suivit pour finir une course contre le cu-nimb, afin de se poser avant que ses vents de cisaillement ne nous en empêchent et nous contraignent à revenir à Neuquèn.

Ce fut la première fois que j’aperçus des mammatus, ces nuages en forme de bouloches, conséquences d’une météo très instable. Jamais je n’aurais fait un tel vol si j’avais été seul. Mais il fallait croire que nous avions de la chance jusqu’au bout, car une fois les trois avions du Raid posés, le grain, comme pour reconnaître sa défaite, s’estompa et nous offrit un merveilleux couché de soleil sur Santa Rosa.

Après cela, la route du lendemain vers Buenos Aires fut sans encombre. Mais pas sans petites découvertes. Cette partie du pays était très fertile et verdoyante. Constellé de cours d’eau, nous sentions le paysage en dessous de nous beaucoup plus hospitalier. En ouvrant l’œil, nous pouvions apercevoir les multiples haciendas des propriétaires terriens de la zone. Certaines étaient si grandes qu’on eut dit de petits châteaux particuliers. De haciendas en haciendas, nous aperçûmes enfin la côte et entre nous, une ville. Une grande ville, Buenos Aires, la capitale de l’Argentine et ses trois millions d’âmes. Cerné par l’agglomération, l’aérodrome de Morón fut le point final du Raid. Une conclusion un peu terne à mon goût. Peut-être était-ce dû à la fin des vols ? Ou à l’idée de dire au revoir à cette drôle d’équipe avec laquelle j’avais vécu pendant cette période courte mais intense ? Pourtant j’étais heureux d’être à B-S. J’avais déjà eu l’occasion de visiter la ville à mon arrivée en Argentine et j’étais content de retrouver mes amis sur place, de leur raconter un peu tout ça. De laver mes vêtements aussi. De fait, je vis bien la réaction à mon odeur qu’eut Carolina, la fiancée d’Adro, l’ami qui m’hébergeait, lorsqu’elle me fit l’accolade. De nous deux, je ne savais pas qui était le plus gêné…

Ainsi me retrouvais-je à nouveau dans les rues tentaculaires de Buenos Aires. La ville était organisée en suivant un quadrillage perpendiculaire, à l’américaine. Ce qui, à mon sens, rendait l’orientation beaucoup plus difficile : toutes les rues se ressemblaient bordel ! A côté de cela, B-S avait cependant quelque chose de spécial, quelque chose qui faisait son identité. Le quartier du centre, cœur économique de la ville, accueillait des immeubles de style art-déco des années trente, comme l’ancien appartement d’Antoine de Saint-Exupéry, lorsqu’il était pilote sur la ligne sud-américaine. Sur la place de San Martin, trônait la « Casa Rosada », littéralement la Maison Rose.

Le nom n’était pas tiré d’un mauvais programme de Canal+. Simplement, en période de guerre froide, l’Argentine recherchant une certaine neutralité entre les deux grands, baptisa le centre du pouvoir en fusionnant l’appellation de la « Maison Blanche » avec le rouge, emblème de l’Union Soviétique. Un résultat logique donc, mais…cocasse. Plus au nord, se trouvait le quartier de « Recoleta », concentrant les populations les plus aisées de la ville. Pas besoin d’en faire une description trop longue. Les rues, le style des bâtiments : pour faire simple, Neuilly-sur-Seine en Amérique du Sud. A l’ouest du mémorial de la guerre des Malouines se trouvait la gare routière et l’entrée vers le « Retiro », un « barrio » nettement plus pauvre. Et plus au Nord, je créchais au quartier de Palermo, dont le style italien était très prisé par les expatriés français. Que ce soit dans la rue ou dans les bars, le matin ou lors de soirées, les gens étaient amicaux et il était très facile d’aborder quelqu’un, pour un renseignement, ou simplement discuter. La ville était à l’image du pays : un mélange fort de plusieurs cultures européennes, mais animé par l’esprit latin. Tout en elle disait : « nous avons appris de vous, mais le dallage de notre chemin nous revient. » Un cri ressemblant à un pied de nez à son ancienne rivale, l’Angleterre, ennemie improbable de la guerre des Malouines, dont le douloureux souvenir restait présent, partout où je suis allé.

L’Angleterre. « Cette colonie française qui a mal tourné », comme disait Clémenceau et dont la capitale, Londres, par laquelle je fis escale pour rentrer, semblait, elle, comme empêtrée dans sa propre situation. Les métros en panne, les embouteillages, la grisaille, les gens se marchant dessus… Surtout, cette ambiance d’incertain chapeautée par un Brexit ambiant. Elle vivait, bien sûr, la capitale britannique. Elle faisait sentir sa portée historique et internationale. Mais outre Atlantique, il y avait ce pays dont je revenais. Petit par son poids dans la politique du monde, mais grand par son envie de rayonner, tel le soleil de mai qui orne fièrement son drapeau.
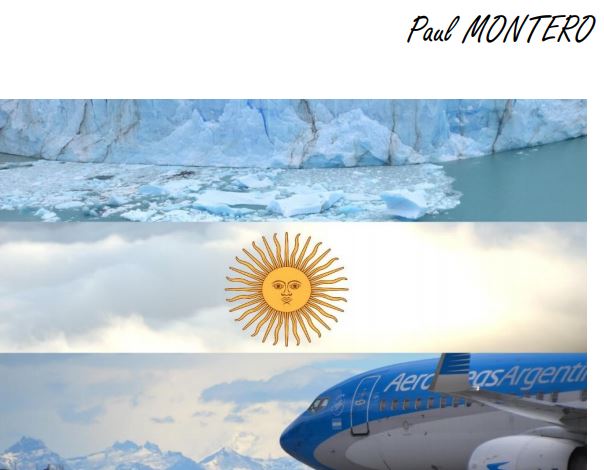

Comments are closed